Résumé
Kerry Salter a passé sa vie à esquiver deux choses : sa ville natale et la prison. Sa dulcinée y croupit d’ailleurs depuis quelque temps. Armée de sa grande gueule et de sa rage, elle lutte contre les inepties du monde. Alors que son père est sur le point de mourir, elle doit se rendre au plus vite à son chevet. Chevauchant sa Harley à travers le bush, elle revient dans le foyer familial et apprend que la terre de ses ancêtres est menacée par un projet de construction d’une prison. Tandis que le combat s’intensifie pour arrêter le projet, de vieilles blessures s’ouvrent. Entourés par les fantômes et les souvenirs de leurs aïeux, les Salter sont animés par le besoin profond de faire la paix avec leur passé tout en essayant de donner un sens à leur présent.
Avis
Kerry est Celle qui parle aux corbeaux. De retour dans le bush australien tant pour fuir la police après un casse qui a mal tourné que pour assister aux derniers instants de son grand-père, elle retrouve sa famille, mais aussi le racisme et la vie difficile qu’elle connaît depuis l’enfance.
Merci à Babelio et aux éditions du Seuil pour l’envoi de ce roman. J’aime beaucoup l’Australie, c’est un pays qui m’attire et que j’ai déjà eu l’occasion de découvrir à maintes reprises à travers la fiction, aussi étais-je ravie à l’idée d’y replonger littérairement. Malheureusement, ma joie s’est arrêtée là.
Dès les premiers chapitres, j’ai compris que je n’accrocherais pas. Si l’auteur et / ou le traducteur étaient payés au « putain », félicitation, les voici millionnaires. Dans le cas contraire, je ne vois pas l’intérêt d’en avoir fait l’un des mots (si ce n’est LE mot) les plus récurrents du livre. Et un tel niveau de vulgarité, ce n’est pas pour moi.
J’imagine que c’est pour montrer que ces pauvres gens ont une vie rude, qu’ils ont dû s’endurcir pour survivre, ce qui passe évidemment (non) par un langage aussi ordurier. Le problème ? Je n’ai ressenti aucune empathie pour eux.
Ce roman est très… dans l’air du temps. Autrement dit, il coche toutes les cases. L’héroïne noire et lesbienne (si, si, je vous assure, elle est lesbienne, elle le rabâche assez tout du long pour qu’on n’en doute pas un seul instant, et ce même si elle finit avec un homme blanc. Pardon, elle fait l’insigne honneur à un homme blanc d’être avec lui. Ça aussi, elle ne manque jamais de le rabâcher), le frère noir et gay, le sexisme, le racisme, l’homophobie…
De quoi inspirer la compassion, en somme (non plus). Car les protagonistes sont exactement ce qu’ils critiquent. Kerry, par exemple, passe tout le récit à injurier (entre autres) le maire et à le traiter de voleur parce qu’il a dérobé le sac à dos accroché au guidon de sa Harley. Sa Harley volée. Et que contenait le sac à dos ? Le butin de son dernier casse. Mais bon, c’pas pareil, si les noirs sont obligés de voler, c’est à cause des blancs.
Alors, j’aurais pu concéder à cette œuvre le fait de ne pas être manichéenne, malgré l’opinion très tranchée de la protagoniste, puisque tout le monde ou presque (j’ai quand même réussi à apprécier Donny et Steve, et je n’ai pas de reproches à faire à Black Superman) est détestable, indépendamment de la couleur et du genre.
Sauf qu’il y a la fin. La happy end. Où tout se conclut de la meilleure façon possible pour la famille Salter, tandis que le vil oppresseur spolieur blanc paye le prix de sa cupidité. Dommage, je n’aurais pas été contre l’idée de voir Kelly refaire un petit tour en prison, elle qui passe son temps à répéter qu’elle est sous mandat d’arrêt, mais qui va et qui vient à califourchon sur sa Harley rutilante en méprisant le reste du monde.
Au-delà de ça, j’ai vraiment eu du mal avec la plume, et pas seulement pour les monceaux de grossièretés dont elle nous abreuve à chaque page. Il y a TROP de personnages, avec des noms étranges (Black Superman, Dr. No) ou similaires (Tall Mary, Pretty Mary). La famille compte je ne sais combien de branches, et il a fallu que j’atteigne presque la moitié du livre pour réaliser que Donna n’était pas officiellement morte, seulement portée disparue tellement je me perdais dans leurs histoires.
Pire, il y a TROP de dialogues. Ils parlent, jurent, parlent, s’insultent, parlent… C’est tellement bavard ! Si seulement l’auteur avait mis autant d’énergie à décrire le bush et à nous faire aimer cette île pour laquelle les Salter se battent (enfin, ils essayent, les rares fois où ils ne sont pas en train de se crêper mutuellement le chignon). Je m’attendais vraiment à être transportée sur cette terre, or j’ai eu le sentiment que l’intrigue aurait presque pu se dérouler n’importe où, avec n’importe quelle minorité.
Enfin, si on fait abstraction des termes aborigènes et anglais qui pullulent presque autant que les obscénités, et qu’il convient de très vite assimiler pour parvenir à suivre (oui, vous découvrirez même le mot spécifique pour aller faire ses besoins). Et au niveau de la culture, de la communion avec la nature, eh bien on a des gens qui tapent la causette avec les animaux. Ils ne communiquent pas d’une façon un peu mystique, non, ils discutent. Réellement. À la façon de Cendrillon avec ses souris ou d’Ariel avec ses poissons. Oh, et de temps en temps, des fantômes leur filent un coup de main. Loin de moi l’idée de manquer de respect aux croyances et coutumes aborigènes, mais tel que c’est présenté dans ce livre, j’ai eu du mal à trouver cela crédible.
Vous l’aurez compris, ce roman est, pour moi, une déception. Je n’ai pas réussi à m’attacher à ses protagonistes qui me sont restés antipathiques jusqu’au bout, et je n’ai pas non plus été transportée au cœur du territoire australien comme je l’espérais avant d’entamer ma lecture. Je remercie tout de même encore Babelio et les éditions du Seuil pour cette découverte.
Note : 2 / 5
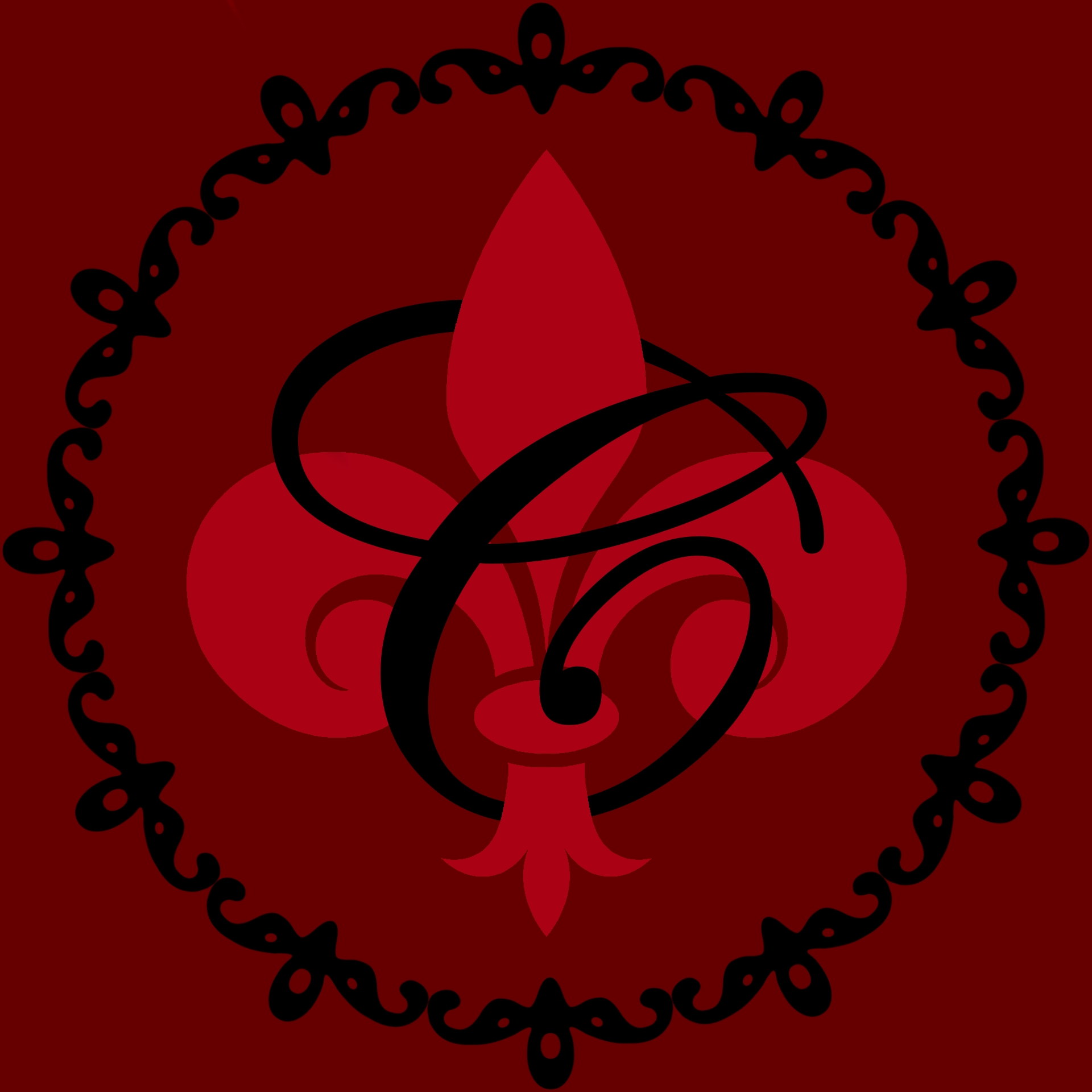

Laisser un commentaire